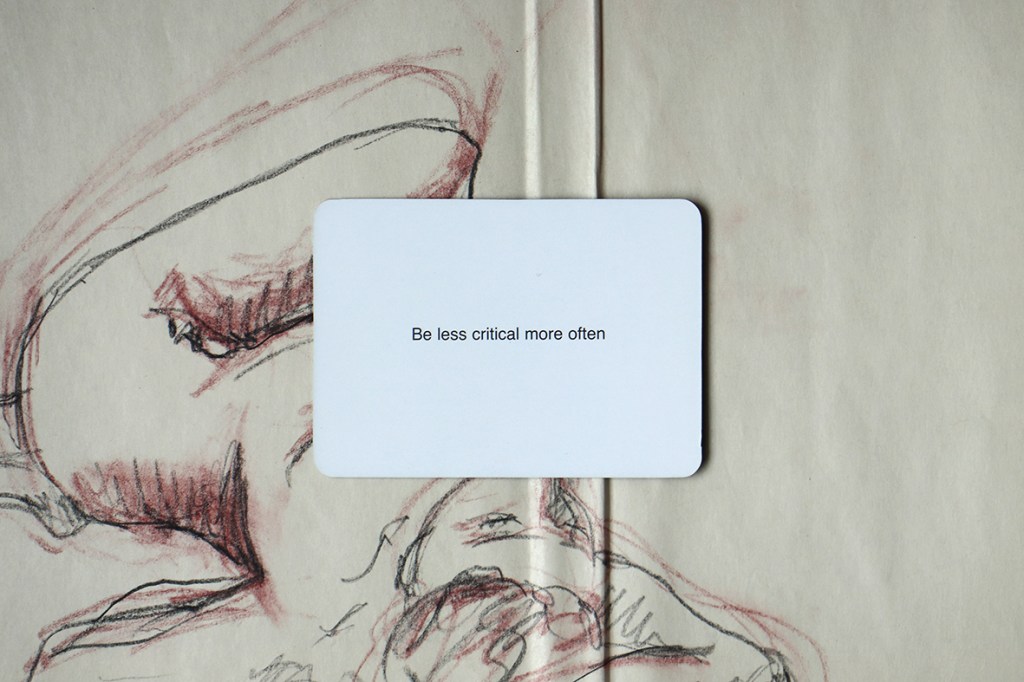Au Bal, À partir d‘elles, Des artistes et leur mère, je pense terriblement à ma mère, aux chantiers abandonnés, il faudrait retrouver une routine, la tension nécessaire pour au moins rouvrir les fichiers, regarder les films. Nous nous enfonçons un peu dans le 9ème arrondissement, nous nous réfugions (il pleut il fait froid) dans un restaurant Hongrois, présence fantôme d’Anne-Marie Garat, la connivence avec notre voisin de table au moment du dessert, le sentiment du manque en pensant à Nina.
C’est la deuxième fois que je rêve de Marion en quinze jours, je devrais prendre de ses nouvelles. Cette fois elle habite à Granville, je lui rends visite en quête d’une chose que j’ai déjà oubliée, je trouve une liste qui prouve je ne sais plus quoi, j’appelle mes parents pour leur dire la vérité, je rentre en prenant un bus, à mi-parcours, je réalise que je n’ai pas pris de billet.


L’enfant juché sur le muret pour pouvoir tripatouiller l’arbre, le métal de la rambarde s’enfonce dans son abdomen, je me demande s’il ne risque pas de tomber en contrebas sur le stade, combien de mètres ? trois peut-être… il n’y a pas d’adultes autour de lui, pauvre folle de penser des trucs pareil, je m’éloigne. Les jours suivants je suis rassurée de ne pas découvrir dans les journaux un titre évoquant la chute mortelle d’un enfant dans le 10ème arrondissement.
Elle m’envoie un texto, me demande si on a prévu quelque chose pour l’anniv de papa, je lui dis que non, qu’on fera avec elle, Tu arrives quand ? Bah je voulais faire une surprise. Nous gardons le secret.

Et les gens se plaignent de la pluie. Nous nous retrouvons une ou deux fois l’an, notre dialogue à trois est de plus en plus direct, essentiel, le lendemain je leur écris que nous quittons nos oripeaux de mères, nous n’avons presque pas parlé de nos enfants.
Quand même les scénaristes ont du bien rigoler en écrivant la scène de la princesse Anne sortant de sa caisse où elle écoute David Bowie, et de la faire entrer dans Buckingham Palace chantonnant Starman, La, la, la, la, la… La, la, la, la, la… La, la, la, la, la…


Avec Alice nous regardons notre journal vidéo, nous jouons aux devinettes. les plans sont suffisamment anciens pour que parfois nous nous demandions si nous en sommes bien les réalisatrices. La chambre niçoise de Nina apparaît à l’image, Alice s’extasie, c’est une chambre de princesse, sa chambre c’est Peau d’Âne en mode grunge. Le soir, l’arrivée surprise de Nina, la joie de Philippe.