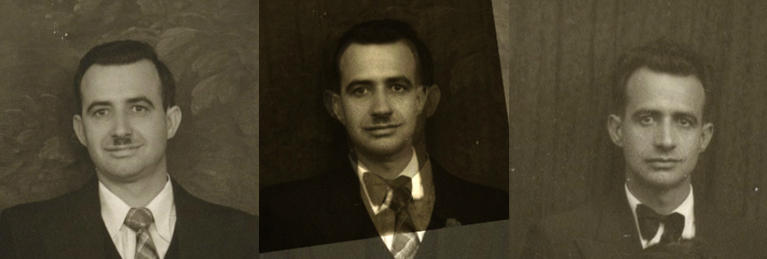Nous allons nager avec Magali, testons un bassin olympique, retrouver le goût de l’eau, la clarté, le bleu, le parfum du chlore, mains raidies trop vites. Traverser la Grange aux belles pour la visite du siège du Parti communiste, ses allures de vaisseau à l’intérieur, je me demande si ma tante Annie y est déjà entrée, trente années à vivre en face, à les défendre passionnément pendant les repas du dimanche. On veut monter sur la terrasse, à l’accueil on nous bouscule, dépêchez vous ça va bientôt fermer.


Dans le train pour Combs-La-Ville, toujours nous montons à l’étage, depuis Brunoy apercevoir les rives de l’Yerres, les maisons de la rue des Vallées, envie d’y aller, peut-être retrouver la maison des Breffort, pensais ce chapitre clos, mais la lumière de septembre, le charme des villas anciennes justifient l’exploration. Dans la soirée les doutes de Nina, l’inquiétude d’Alice, c’est décidé elle part pour Catane demain.
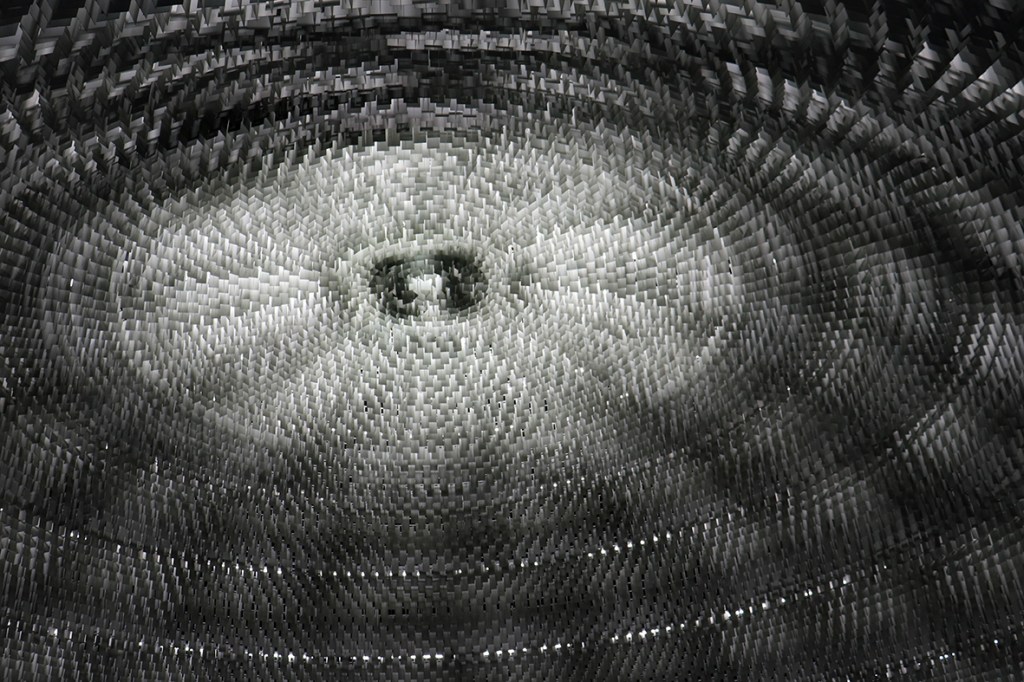

Plusieurs réveils dans la nuit de lundi, la pleine lune, je la photographie qui joue avec les nuages, j’aperçois la grande araignée taquine dans l’encoignure de la fenêtre.
Rendez-vous annuel chez l’expert comptable, la veille avais observé sur le plan de Paris la proximité du cabinet avec la place de l’Étoile, ce matin découvrir l’Arc drapé, blanchi de lumière, le bleu si franc derrière, une présence irréelle, saisie, émue, malgré le flot d’images déjà parues, malgré la circulation ouverte en semaine, prise par le temps, me promets d’y revenir pour les détails.

M’accorde le temps d’écrire un texte pour l’atelier, tout se tend en cette rentrée, résister à la frénésie ambiante. Je découvre la revue à (re-)naître de François Bon, grande envie d’y participer, même si je devrais me méfier de mes emballements, et finir peut-être un des chantiers ouverts.

Le temps s’ouvre un peu, quelque chose de joyeux, laisser faire. Je sauve quelques images de la semaine, j’apprécie le poids de l’appareil, l’effort du cadre, l’intention, et toujours ce temps décalé pour découvrir les photos sur l’ordinateur. De bonnes nouvelles de Nina depuis la Sicile, le voyage a pris un tournant inattendu et heureux.
Soirée amicale, Simona l’amie italienne d’Arnold me demande quels sont nos liens avec l’Italie, j’évoque l’arrière-grand-père du Piémont, Bagnatica, j’entends la voix de ma mère marquant l’appui sur la deuxième syllabe, un village près de Bergame, elle me reprend, Mais c’est la Lombardie ! Depuis toujours j’avais entendu — enfin il me semble — qu’il venait du Piémont, arrière-grand-père c’était suffisamment lointain pour que l’approximation maternelle me contente, mais si je l’écris je dois être juste, cette confusion me touche, sa fragilité qui dit tant sur la famille, ses croyances et légendes.