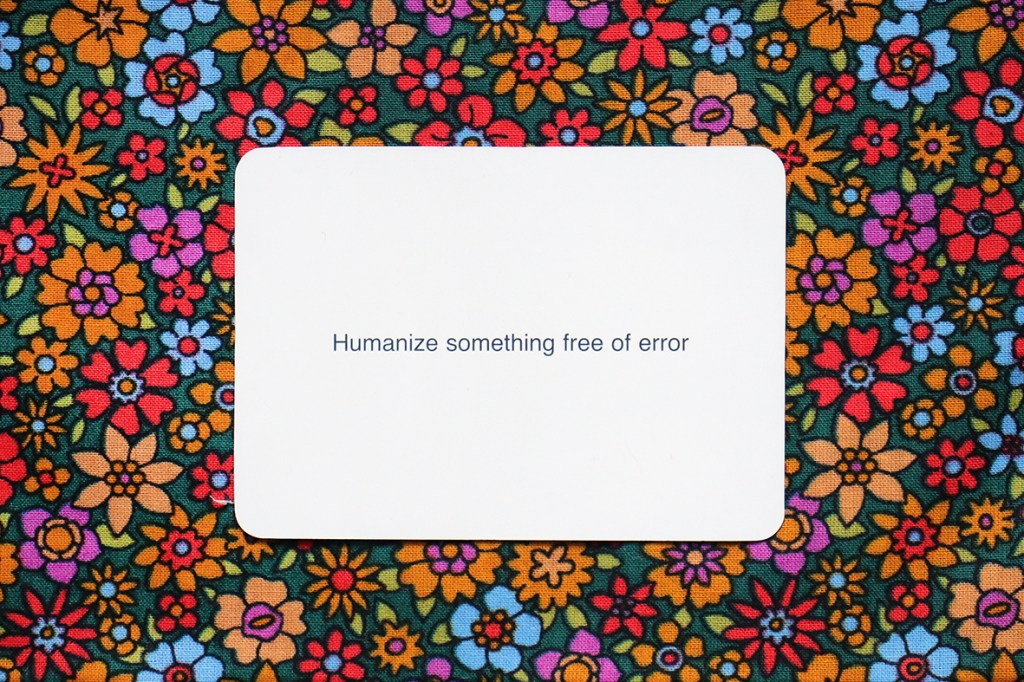Sur le quai de la station Commerce l’emballement du cœur. N s’émeut devant mes cheveux courts et gris, forcément je lui rappelle ma mère. Anecdotes de la cité, j’écoute en souriant, à la fois dedans et dehors. Traverser le Champs-de-Mars puis le pont Alexandre III pour la première fois, regarder la ville avec les yeux d’une autre.

Elle me rend l’exemplaire de Comanche qu’elle a recouvert de papier kraft pour le protéger, elle n’a pas pu le lâcher, elle attend la suite. Cette idée de suite me surprend, quelle suite tu imagines ? En attendant tous les projets sont à l’arrêt, seul ce journal me donne l’illusion que j’écris, et bien sûr l’atelier de F.
Dîner chez Z avec les amies mamans d’école. Leurs visages, nos énergies, les plats colorés, le patio, les cigarettes, les discussions qui se prolongent tard dans la nuit. Est-ce d’avoir vu les ami·es d’Algérie deux jours avant ? Je les quitte en pensant à ma mère, en tête cette photo en noir et blanc où elle fume, assise au sol, entourée de ses amies algéroises.

La sensation d’un grain de sable sous la paupière, la vue troublée par le larmoiement, viser la lumière est trop douloureux.

Je photographie les présents, une robe et un porte-monnaie kabyles rapportés par N, le bracelet de perles œil de chat que S a retiré de son poignet pour me le donner, cent cinquante dinars algériens, avec lesquels je pourrais acheter deux pains et un kilo d’oranges. La robe ne ressemble pas du tout à celles dont je me souviens dans l’enfance, mais les motifs me rappellent les bijoux en argent émaillé que N ne manquait pas de nous offrir quand elle nous rendait visite avant la guerre civile.
Vous avez un corps étranger dans l’œil. J’ai d’abord l’image d’une silhouette minuscule plantée dans mon globe. Elle m’explique qu’elle va le retirer avec une petite aiguille, puis gratter un peu la cornée, je ne peux pas partir en courant, l’anesthésiant est heureusement très efficace. C’est une poussière de métal, la douleur remonte à mardi, alors je me rappelle avoir limé une plaque de cuivre à l’atelier de gravure.


L’air est humide, la ville minée d’un gris plombé. Je n’avais jamais remarqué le tamaris de la rue des Écluses, tu ris, tu l’as pris en photo plusieurs fois, enfin le yucca à coté, ses petites grappes roses me réjouissent, c’est idiot mais ça me donne l’impression d’être à Carolles.