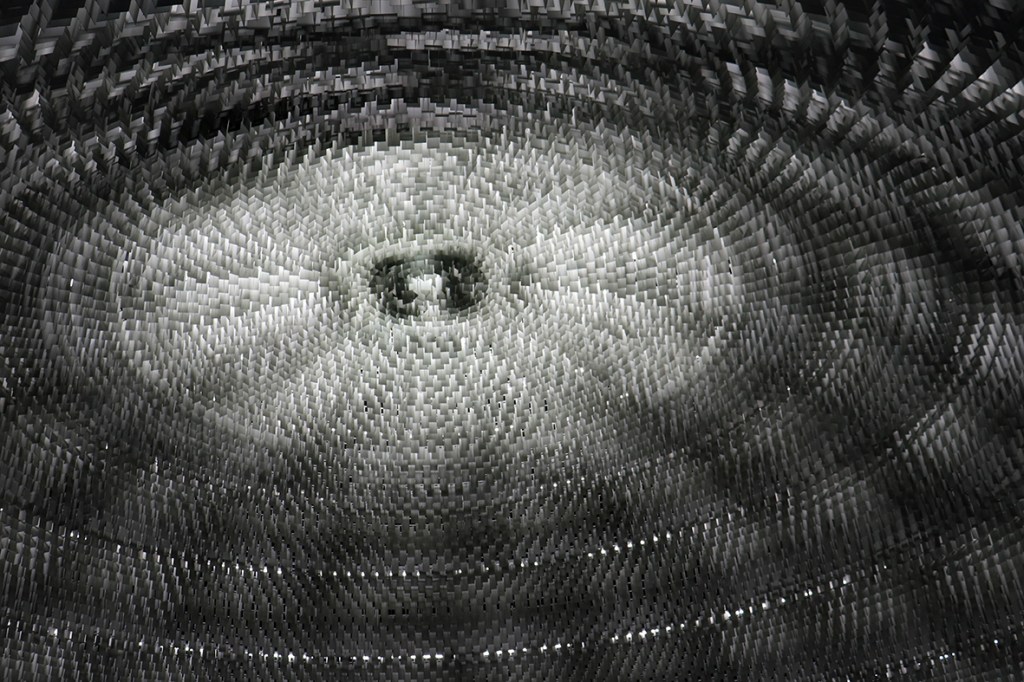Il y a dans l’histoire de mon père telle qu’elle a été livrée nourrie arrangée un doute sur sa filiation. On disait que son père n’était pas son père. On disait que son père était un homme de théâtre dont ma grand-mère avait été amoureuse — et la maîtresse. Son nom circulait dans les conversations. Mon frère ainé en porte le prénom, c’est ce qu’on disait. J’ai fini par retrouver un membre de la famille de l’homme de théâtre (les sites de généalogie sont des mines exceptionnelles) avec qui j’ai eu des échanges assez amusants. Ça ne m’a pas aidée à décider de qui mon père était le fils — je crois que j’ai fini par renoncer à ce mystère, les ressemblances on est bien capable de les inventer, les visages on leur fait dire ce qu’on veut. Mais il y avait cette photo exceptionnelle de ma grand-mère avec Jeanne B, la sœur d’Alexandre, prise à Brunoy. Il y avait dans les souvenirs de Clo de belles journées passées à la meulière. Il y avait que ma mère — lors de notre dernière grande migration — a choisi de venir s’installer justement à Brunoy, à cette époque je me tenais sagement à l’écart de mon père.


Ce sont les échanges avec la descendante de la famille B qui ont éveillé ma curiosité, elle me confirmait les dires de Clo sur la situation de la maison au bord de l’Yerres, croyait se souvenir qu’elle est sise au 122 rue des Vallées. L’idée est restée en suspens — comme le texte en sommeil — d’aller explorer ces rives de l’Yerres pour voir si je retrouvais trace de la maison où sans doute mon père avait passé quelques dimanches. C’est en allant récemment chez les parents de Philippe qui habitent un peu plus loin sur la ligne que je vis l’Yerres serpenter au-delà des voies ferrées depuis la fenêtre du train, et que je me suis décidée à y aller prochainement.


Ce dimanche où nous y retournons déjeuner, excitée par l’inédit d’une échappée en solitaire, le ciel bleu à peine voilé de trainées de condensation, je suis partie une heure en avance pour aller explorer la rue des Vallées. Elle est là, à l’aplomb de la voie ferrée dans la direction opposée de l’endroit où nous vivions avec ma mère, d’abord avenue bien entretenue plantée de tilleuls proprement taillés, bordée de meulières coquettes et de maisons plus récentes, bientôt plus étroite et cabossée, percée de contre-allées verdoyantes. J’accélère le pas, le temps est un peu serré, la rue est longue, la progression des numéros bien trop lente. Je me retrouve brutalement devant le 130, retourne sur mes pas, au 122 il n’y a qu’un petit jardinet au bord de l’Yerres, en partie terrassé, fermé par une grille.
Je crois au loupé, puis me souviens de la description de Clo, une maison d’un côté de la route qu’on traversait pour rejoindre le jardinet, je photographie alors la petite meulière qui fait face, me suis dit que oui ce pouvait bien être là la maison d’Alexandre B, même si elle affiche le numéro 127. Le temps compté, l’apaisement, l’incertitude ? Je n’ai pas pensé à mon père, enfin je ne l’ai pas imaginé là jouer dans l’herbe, je n’ai pas senti sa présence, je n’en tire aucune conclusion.