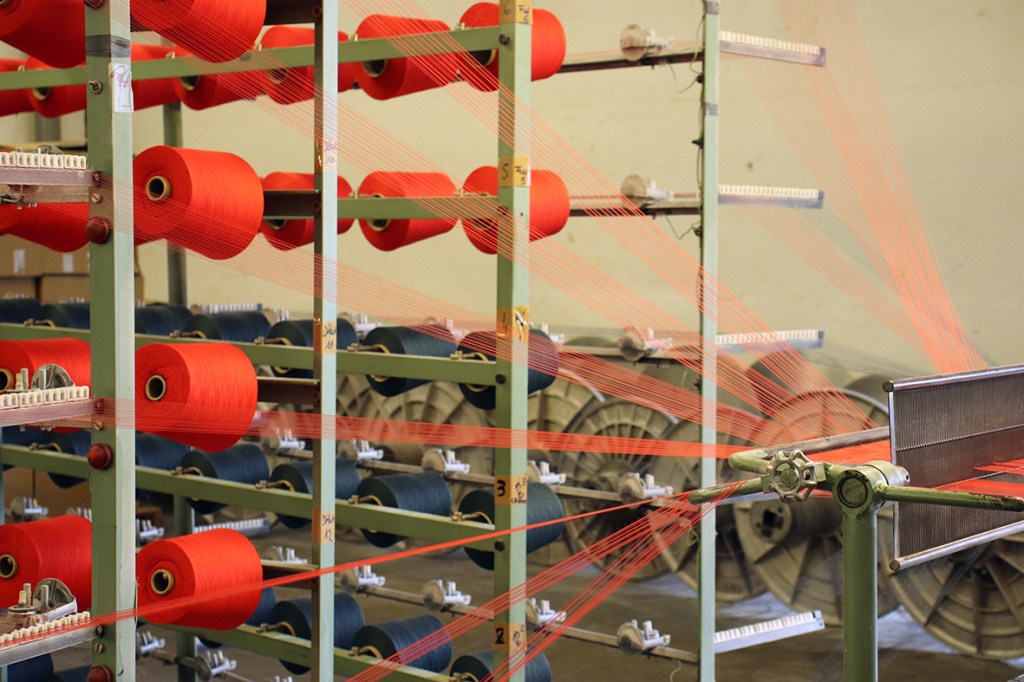Granville 2018 – Source : Atlas des Régions Naturelles – https://www.archive-arn.fr
un oursin géant posé sur l’herbe — depuis le drame de Juigné-sur-Loire tous les enfants devaient apprendre à nager. dans la cabine exiguë elle doute, ses orteils se rétractent sur les mosaïques blanches. le parfum de chlore ne la dérange pas, elle a même une certaine attirance pour cette odeur, sa mère utilise souvent de la javel à la maison, c’est presque réconfortant — mais le polyamide brillant du maillot qu’elle enfile pour la première fois l’oppresse, comme les sous-pulls qu’on s’entête à lui faire porter, toujours l’impression que le vêtement étriqué va lui arracher les oreilles quand elle l’enfile, que le corps ne peut pas respirer en dessous. et le rouge vermillon d’où s’échappent ses jambes trop maigres est beaucoup trop voyant qui fait ressortir les marbrures de sa peau. les cheveux même coupés courts sont tiraillés par le latex du bonnet trop serré. les voix des camarades montent en échos de cathédrale. elle entasse les vêtements dans le panier en plastique, les chaussures calées au fond, chaussettes en boules âcres dedans, la culotte elle la cache à l’intérieur d’une jambe du pantalon. novembre c’est pas un mois pour aller à la piscine. elle fait basculer le loquet qui ferme la porte de la cabine, ne s’attendait pas à sa chute brutale, sursaute. pousse la porte du bout des doigts, accroche le panier dans le vestiaire au milieu des autres. maintenant elle se dirige vers le bassin, ses pieds suivent une ligne de carreaux noirs. les épaules en dedans elle grelotte à sentir sous les pieds le sol froid et humide. le truc qui la rassure c’est que nager elle a appris durant l’été. il y a toujours son pied droit qui refuse de se mettre en dehors quand elle nage la brasse, les allers-retours à marcher façon Charlot le long du bassin du club Mickey n’y ont rien changé. mais elle sait nager. elle abandonne sa serviette fanée sur le banc carrelé, se glisse derrière ses camarades. elle approche du bassin, son pied droit se déforme sous l’effet d’une crampe. debout sur le plongeoir elle fixe la lumière qui filtre à travers les hublots du coquillage géant, se perd dans la vibration turquoise. Allez, le cri du maître nageur rompt sa rêverie, l’eau vient pincer les sinus, ce n’est pas désagréable
Merci à François Bon d’avoir proposé aux membres du Tiers Livre d’aller explorer l’Atlas des Régions Naturelles, d’Eric Tabuchi et Nelly Monier où j’ ai retrouvé ma piscine d’enfance.