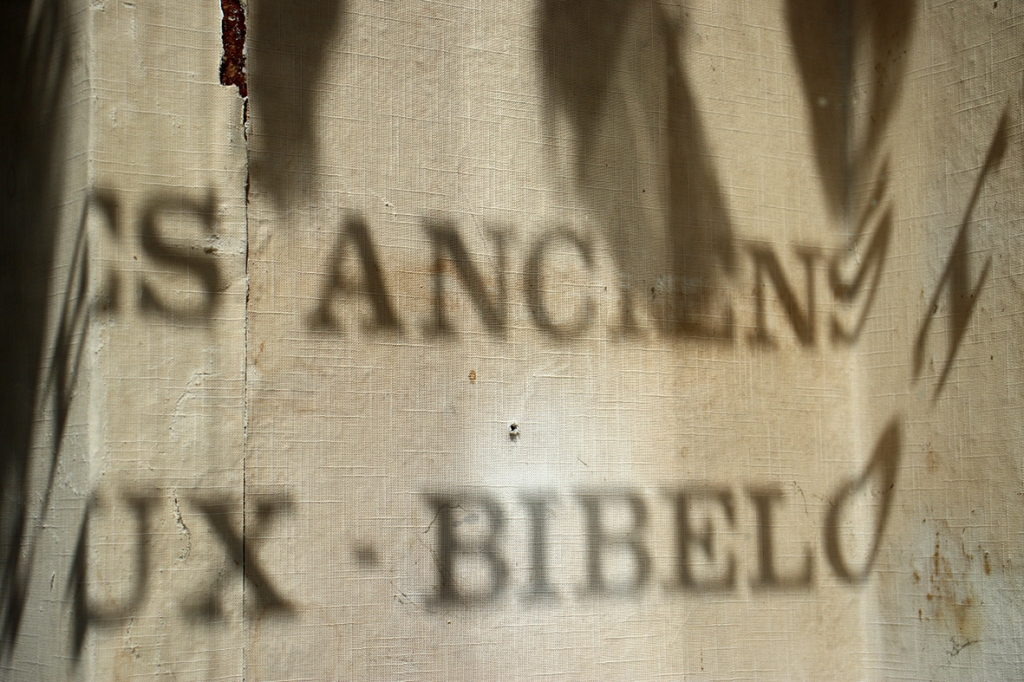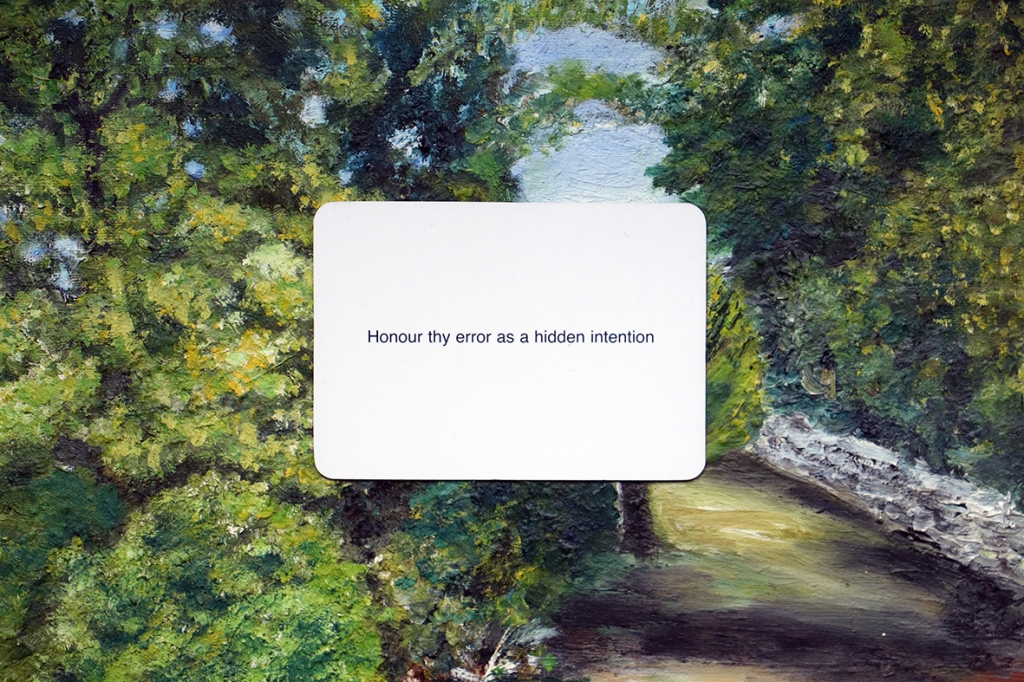La présence de J — l’amie d’enfance d’Alice, le RER D, la tante de Philippe retrouvée sur le quai de la gare, le repas du dimanche, les pâtisseries orientales que nous avons apportées, la partie de cartes, les rituels et leurs infimes variations.
Véronique Aubouy entre en scène avec l’énergie d’une sportive, son bouquin de deux kilos à bout de bras. Elle dit qu’elle va tenter de résumer La recherche du temps perdu en une heure, demande à la salle quelques jalons, on lui répond le bal des têtes, quelque chose à propos de Venise, Charlus. Au fil de la performance improvisée ce sont nos propres souvenirs, nos émotions de lecture qui remontent. Sa ressemblance avec ma tante chérie me frappe, les portes du train qui se ferment à Venise font apparaître le visage de ma mère.


On avait bien vu sa fatigue, et son corps s’est soudainement alourdit. V a eu de bons réflexes, on l’a couchée au sol, L est arrivée dans la salle d’encrage, s’indignant gentiment qu’on ne l’ai pas appelée — je suis médecin tout de même, l’attente des pompiers, enfin la sirène qui s’approche.
Les archives de la planète au musée Albert Kahn. On s’imagine y passer des jours, la collection est immense, on aimerait par hasard retrouver un lieu intime qui ferait partie de l’inventaire. C’est finalement le regard de cette petite fille, une sorte d’Alice aux pays des merveilles, qui dans le poing fermé qu’elle tend devant elle retient un secret. Puis dans le jardin son petit double contemporain.



Sur les pierres chaudes la vapeur les enveloppe, leur donne un tel sentiment d’intimité qu’elles parlent comme si elles étaient seules au monde, et nous obligent presque au silence.
Je reçois la lecture de la lettre d’Oran par Christine Jeanney, j’ai pensé à elle parce que sa voix est pleine d’une même chaleur que celle de ma mère. L’idée de monter ensemble ces archives transmises par mon cousin — la lettre d’Algérie et quelques secondes de film où ma mère se maquille — m’obsédait depuis quelques mois. J’ai de la chance que mes tantes maternelle et paternelle aient chacune eu ce même goût de l’archive, quand ma mère s’obstinait à faire le vide.
La lettre d’Oran, ici.

Mon ami dentiste me demande comment ça va, j’évoque ma cornée sensible, il me rassure, se moque gentiment de moi, il faut bien des petits soucis. Le dialogue devenu impossible, d’ailleurs avec ses filles elle a arrêté la discussion, ça sonne comme une mise en garde, et je suis désarmée.