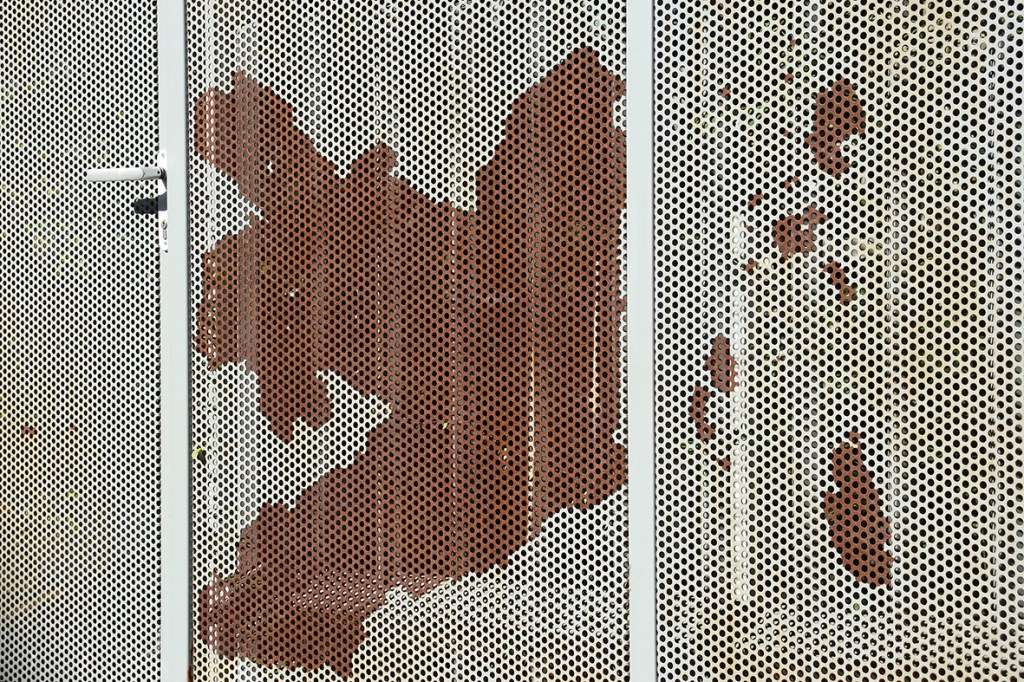Bon pour un voyage sur les pas de tes héroïnes anglaises, c’était un cadeau fait à Alice pour ses vingt ans, enfin on y arrive.


Quelques heures après la traversée du pont Lafayette, nous sommes à Lewes, nous attendons le bus pour Rodmell où la petite vieille évoque la ferme qu’elle a eu autrefois, Mais tout a changé. Nous avons posé les valises à la roulotte louée pour la nuit, et sommes arrivées devant Monk’s house, là où Virginia Woolf a écrit une majeure partie de son œuvre. Là où avec Léonard ils finissent par se réfugier après qu’un bombardement ait endommagé l’appartement de Londres. Un peu en avance pour la visite, nous découvrons le jardin immense, les pommiers, un potager, l’étang, les étendues d’herbes où on peut s’installer comme chez soi, trois jeunes filles goûtent le jour bleu dans les transats mis à disposition.


Nous entrons, avançons par petits groupes dans la maison aux murs colorés qui nous font oublier les lambris blancs de la façade. Dans chaque pièce un bénévole amoureux nous raconte les aménagements successifs, le fauteuil préféré de Virginia, les livres qui envahissent la maison, les visites de T. S. Eliott, E. M. Forster, de sa sœur Vanessa, Duncan Grant… Il y a des tableaux, des portraits, des esquisses, des lettres, des bibelots posés sur les cheminées, temps figé, la veille encore on se réunissait à Monk’s house.



En entrant dans la chambre de Virginia l’impression que les voix s’amenuisent, peut-être la peur de réveiller les fantômes. Dans cette chambre Virginia n’écrivait pas, se reposait, recouvrait ses livres de beaux papiers pour calmer ses crises de migraine. On ne visite pas l’étage.


Dans le jardin, l’abri construit par Léonard, A Room of One’s Own. Sur le bureau une mise en scène de désordre — qu’elle aimait — avec des papiers chiffonnés. « Comme j’aimerais — je me disais cela pendant la promenade en auto cet après-midi — écrire de nouveau une phrase ! Que c’est merveilleux de la sentir prendre forme et se courber sous mes doigts ! Depuis le 16 octobre dernier, je n’ai pas écrit une phrase qui fût neuve. Je n’ai fait que recopier et taper à la machine. Une phrase dactylographiée n’est pas tout à fait la même. Pour une part, elle est faite de quelque chose qui existe déjà. Elle ne jaillit pas toute fraîche de la pensée ». Par la fenêtre qui fait face à la chaise de travail on voit le mont Caburn, à l’arrière des herbes envahissantes ondulent sous le vent.

Le lendemain nous sommes parties à pied vers Southease, frissons en passant au dessus de l’Ouse — elle aurait traversé les champs, personne n’a aucune idée de l’endroit où elle s’est noyée. À la gare nous retrouvons les trois jeunes filles croisées la veille au jardin, puis au pub, elle, que j’ai photographié à la sauvette parce que je lui trouvais une certaine ressemblance avec Virginia.