
En pèlerinage, retrouver le vert bleu gris de la Manche à Blonville. Cela fait plusieurs années que nous ne sommes pas allés dans le Cotentin. L’air iodé me fait l’effet d’un rappel : Edenville me manque. Nous devons rejoindre Cabourg pour un déjeuner de famille. Avec Philippe, nous partons un peu plus tôt, pour voir la ville avant l’arrivée de la foule des dimanches. Nous marchons sur la promenade Marcel Proust. Par curiosité, nous regardons le prix qu’il faut payer pour dormir dans une chambre inspirée de celle qu’il occupait, il y a plus d’un siècle. Quatre cents euros la nuit pour une illusion. Et la vue sur la mer. La mémoire ne se monnaye pas, je préfère marcher. Imaginer ce qu’on ne voit pas derrière les façades des villas que nous découvrons dans les avenues de la ville. Ce que je faisais enfant dans le Cotentin : inventer des vies derrière les murs.


Il ne se rend pas compte que là, assis devant son restaurant, regardant fixement la route, son visage est fermé. Il ne se rend pas compte que la barquette en plastique remplie de terre qu’il a posé sur la table en guise de cendrier, dans laquelle il a déjà écrasé une dizaine de cigarettes nous soulève le cœur. Il ne se rend pas compte que la fumée lui revient au visage, qu’elle lui plisse les yeux, qu’on dirait qu’il est en colère, ou fatigué, ou les deux. Il ne se rend pas compte que son expression fait peur, qu’elle nous tient à distance, qu’on préfère passer son chemin et oublier ce qu’on voulait.

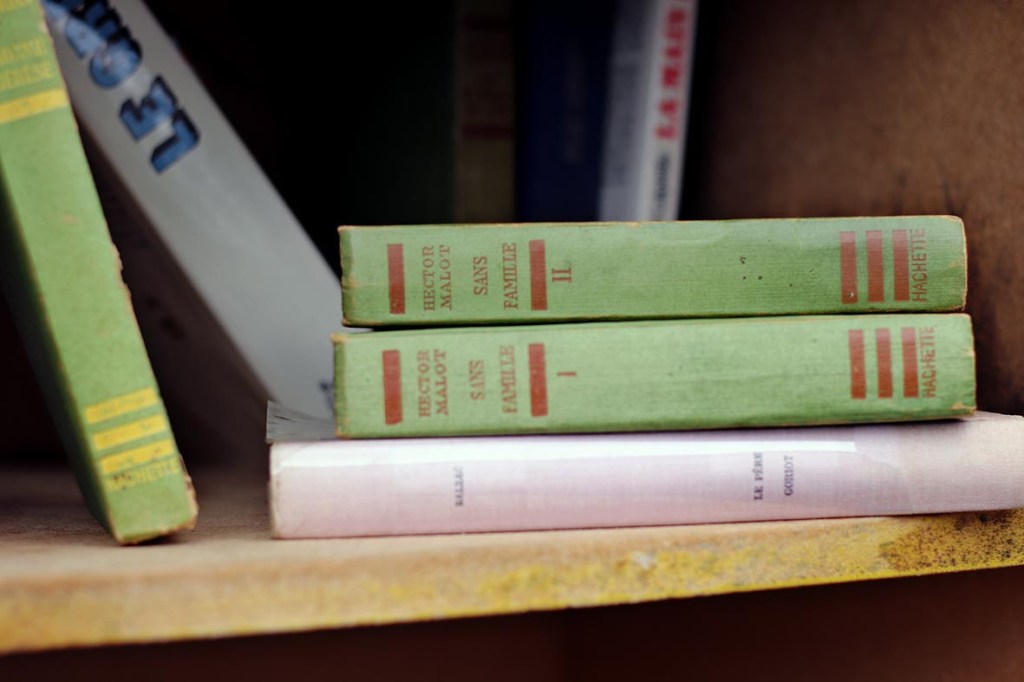

Je vais au Grand Palais pour voir mon amie Céline performer au cœur de Cercles, un atelier recherche chorégraphique imaginé par Boris Charmatz. En sortant du métro j’avais faim mais à cette hauteur de l’avenue des Champs Éysées il n’y a rien, seulement des perspectives immenses. J’aperçois un kiosque, je commande un hot dog gratiné. Je vais m’asseoir sur les marches du Grand Palais, il y a autour de moi le public qui vient pour la danse et je mange mon hot dog dégoulinant de sauce moutarde, je ne suis pas raccord. Philippe me rejoint, nous entrons dans la nef et nous assistons médusés à l’atelier spectaculaire. Deux cent danseurs, des amateurs, des professionnels, des corps singuliers, de tous les âges, de toutes corpulences. Réunis à l’intérieur d’un cercle, ils répètent une chorégraphie mouvante, qui se construit sous nos yeux. Elles et ils sautent, courrent, frappent, grimacent, s’enlacent, lèvent le poing, une langue est en train de naître. Ils reprennent des boucles sous la direction de Charmatz qui leur réclame plus de présence encore. Les corps occupent tout l’espace, des gestes singuliers nous racontent des histoires de peur et d’amour, l’énergie des danseurs nous traverse. La musique de Meute participe à la transe. Nous ne dansons pas, mais nous sommes dedans. Il y a des entrées, des sorties, chaque mouvement nous révèle de nouveaux corps, de nouveaux visages. Nous sommes rentrés à la maison porté par l’energie reçue sous la nef, presques dansants, joyeux.

Je retrouve Anne Savelli au pied de son immeuble. Nous allons arpenter l’avenue Secrétan, sur les traces de Jacqueline, son ancienne voisine. Jacqueline lui a raconté, lors d’une interview, tous les lieux — cafés, boutiques, cinémas, écoles — qui existaient déjà dans son enfance, ceux qui ont disparu, ceux qui n’ont presque pas changé. Anne me les fait decouvrir, comme on déroule une carte vivante, appuyée sur les souvenirs de Jacqueline. Je prends des photographies pour garder une trace de ces lieux au présent, ces lieux qu’Anne s’apprête à quitter. L’exercice me plait. Souvent je pense à Corbera, immobile, en suspens, sans témoins. L’avenue si petite et discrète. Rien qui puisse attirer l’attention, rien qui puisse prétendre à l’histoire. Et pourtant.
























