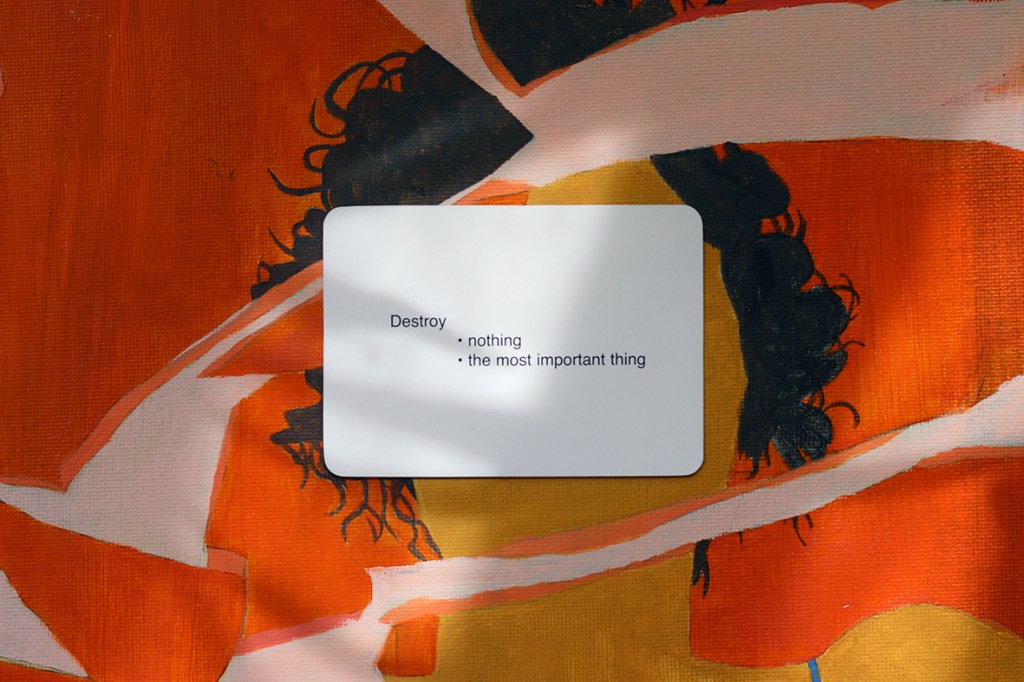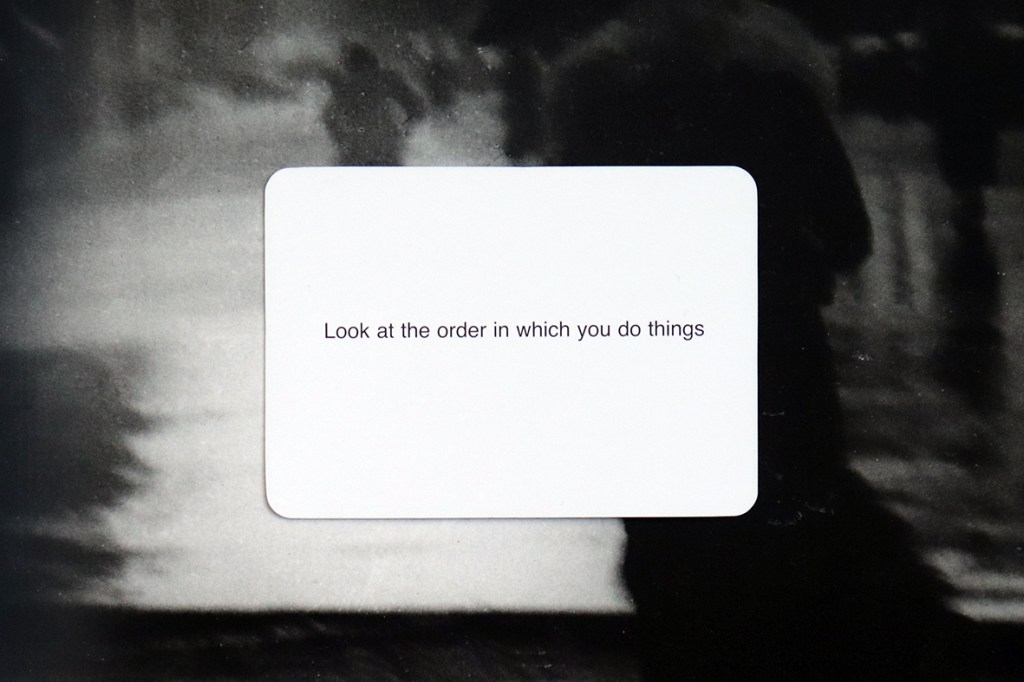Je sais bien que je pars trop tard, mais à force d’écouter Cerno, je me dis qu’il y a une première chose à faire, c’est retourner avenue de Corbera.
Je gare mon vélib boulevard Diderot, me dirige vers la rue Crozatier, chaque visage un peu âgé que je croise nourrit l’illusion que je pourrais rencontrer avenue de Corbera, des personnes ayant côtoyé ma grand-mère, ma tante — qui sait, ma mère enfant. Je prends quelques repères. Devant l’imposante architecture de la poste à l’angle Diderot/Crozatier je me demande si c’est là que travaillaient mes grands-parents. J’entre avenue de Corbera, je n’y ai pas de souvenirs, mes souvenirs sont dans l’appartement, l’ascenseur, le hall. La rue est tellement calme qu’on a du mal à y penser la vie. Depuis mon dernier passage — d’après le journal c’était en juillet 2022, le trottoir pair a été généreusement élargi, on y a même planté des arbres entre des blocs de pavés. Au 14, je lève les yeux vers le premier étage, deux des fenêtres sont nues, la troisième se cache derrière des volets accordéons en PVC. L’appartement semble vide, il y a deux ans c’était déjà le cas. En bas de l’immeuble, de part et d’autre de la porte en verre cathédrale, les deux commerces sont fermés. A gauche, où je me souviens avoir découvert une boutique de chapeaux il y a quelques années, un commerce de CBD, store métallique baissé, à droite une agence de solutions en bâtiment semble toujours en activité, il y a une bouteille d’eau en plastique entamée sur un des bureaux, nous sommes samedi, c’est fermé. Au 16, une galerie/ studio de tatouage est ouverte, je m’approche, à l’intérieur une jeune femme blonde me sourit, je lui demande si elle a le code d’entrée du 14, non, elle me demande pour quoi faire. Je livre ma première version de l’histoire, ma famille qui y a vécu il y a longtemps, le hall que je voudrais revoir, l’ascenseur, et pourquoi pas entrer dans l’appartement. Elle est désolée de ne pas pouvoir m’aider, me dit que la boutique de CBD a le rideau baissé depuis au moins un an, je vais attendre un petit peu, elle m’encourage. Une vieille dame semble se diriger vers le 14, je prends les devants, lui explique que j’aimerais rentrer dans cet immeuble où ont vécu mes grands-parents, elle habite au 12, mais venez avec moi, les immeubles, ce sont les mêmes, je la remercie, mais c’est vraiment l’immeuble de ma famille qui m’intéresse. Je lui demande si elle habite dans le quartier depuis longtemps, oui… elle ne sait pas précisément me dire, une quarantaine d’années ? Peut-être que vous avez connu ma grand-mère, ou ses enfants ? Je prononce leur noms, évidemment ça ne lui dit rien, c’était il y a si longtemps… est ce que moi même je connais les habitants de l’immeuble voisin du mien ? Elle se souvient peut-être de l’épicerie ? de madame Blanchet ? Non, et puis vous savez la rue a beaucoup changé. Elle finit par s’excuser, elle veut rentrer chez elle, elle a des douleurs dans les jambes. Je la remercie encore, je reviens me coller à la porte du 14. Mes mouvements pour extraire l’appareil photo de mon sac se reflètent sur la porte vitrée du hall derrière la porte d’entrée en verre cathédrale, un instant je crois que quelqu’un va sortir de l’immeuble. La rue est désespérément calme. De rares touristes la traversent. Chaque fois que je vois passer une personne un peu âgée, j’ai envie de l’aborder mais je crains de m’éloigner de la porte, de louper celle qui pourrait me donner accès à l’immeuble. Je guette les entrées et sorties des bâtiments qui me font face. Parfois j’ai des illusions sonores, le bruit de l’ascenseur, quelqu’un derrière la porte, ce sont des roulettes de caddies dans la rue Crozatier. Je m’agace d’observer autant d’allers-retours au 5 en face, au 12 à côté, et que la porte du 14 reste close. Je m’amuse de la présence d’une école d’esthétique juste en face, je repense aux images filmées par mon oncle, ma mère et sa sœur se maquillant devant la fenêtre. Un vieillard en veste verte arrive de la rue Crozatier, il s’approche de moi, me jauge, est ce qu’il habite au 14 ? Il me répond mécaniquement que non c’est au 10. Je le laisse s’éloigner, il a peut-être connu des membres de ma famille mais il dégage quelque chose d’inquiétant, je préfère me concentrer sur la possible arrivée d’un habitant du 14. Je traverse la rue pour prendre un peu de recul, je reste un moment tête en l’air à scruter les balcons dont tous les appartements de l’immeuble sont pourvus, sauf celui de ma grand-mère au premier. Aucun signe de vie. Toutes les fenêtres sont fermées. Les volets des cinquième et sixième étage sont clos. Les occupants sont probablement tous déjà partis en vacances. J’envisage enfin de ne pas pouvoir y entrer aujourd’hui. Je regarde l’heure sur mon téléphone, presque deux heures passées là à attendre, l’improvisation a échoué, mais mon désir d’entrer au 14 s’est renforcé.