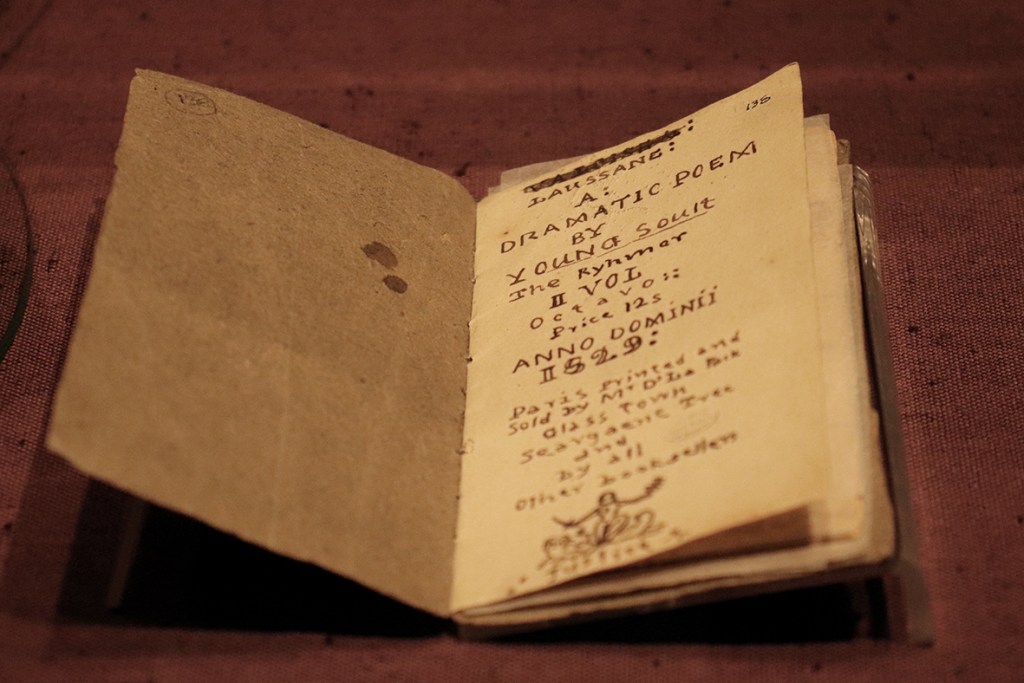En regardant mes photos je m’interroge. Étais-je à ce point émue de n’avoir pas su faire les bons réglages, les cadrages qui révéleraient la beauté de Teshima ? Sans doute que seule la mémoire est capable de conserver cet émerveillement. Teshima, où j’ai contemplé la mer de Seto assise sur un banc de métal, où j’ai écouté battre des cœurs, où j’ai observé des gouttes d’eau sourdre du sol, où j’ai senti la chaleur intense, inquiétante d’un 18 octobre.
Après avoir contemplé l’horizon fermé, après nous être photographiés à l’aide du retardateur assis sur a Place for sea dreamers, nous avons repris nos vélos pour rejoindre l’installation de Boltanski. Dans une petite pièce face à la mer on peut écouter battre des milliers de cœurs. Il y a plusieurs manières d’entrer dans Les archives du cœur, par nom, par lieux. Je cherche en vain des ami.es, j’écoute battre des cœurs d’inconnus. Puis on pénètre dans une pièce obscure, une ampoule s’allume et s’éteint au rythme des battements d’un cœur. Quand on s’en approche, les battements s’accélèrent et s’amplifient, puissants comme une étreinte. On s’éloigne prudemment comme si nous craignions un emballement irréversible.



Gravir joyeusement les pentes, griserie d’air vif dans les descentes, le vélo et sa liberté d’enfance. Nous partageons une pizza juste au-dessus du Teshima Art Muséum. L’architecture en béton blanc aurait la forme d’une goutte d’eau avant l’impact. Sa manière d’être posée sur la pente, les rizières cultivées autour, la chaleur, me transportent au Cretto di Buri de Gibellina. Peut-être que si j’y pense, c’est parce que tout à l’heure, dans la cabane sur la plage, j’ai cherché les battements du cœur d’Arnold.
D’abord il y a un chemin qui serpente dans la nature intense, bruissante de chants d’oiseaux. A l’entrée de l’architecture, on recueille les consignes, les photographies sont interdites, sur le sol il y a des choses fragiles sur lesquelles vous ne devez pas marcher, merci de respecter le silence. Nous enlevons nos chaussures, nous entrons prudemment dans la coquille blanche. Nous sommes reliés au monde extérieur par deux ovales découpés dans la voûte qui laissent pénétrer l’air et la lumière. Le sol est parfaitement lisse, mais on perçoit des mouvements furtifs, de minuscules gouttes d’eau se forment à sa surface, surgissant de terre par d’invisibles ouvertures. Les gouttes glissent pour se rejoindre, elles forment des ruisseaux, des flaques, des constellations mouvantes, des archipels. On observe, souffle suspendu, un monde qui se fabrique sous nos yeux. Le temps s’arrête, nous enveloppe. On marche timidement entre les gouttes, les flaques, sans jamais se gêner les uns les autres, à pas de fourmis. On ne parle pas. On s’arrête, on fait corps avec l’œuvre vivante, entre ciel et terre. Je fais corps, des larmes se forment.



On reprend nos montures électriques pour nous rapprocher de La forêt des murmures, une autre installation de Boltanski. On traverse un village silencieux, on marche longuement, à l’entrée de la forêt un panneau signale la présence de sangliers. Nous ne nous battons que contre les moustiques, jusqu’à être saisis par le chant des carillons suspendus aux arbres du mont Danyama. Ils sonnent comme en écho aux cœurs du matin. Je n’ai pas quitté l’île, que je voudrais déjà y revenir, écouter encore ces âmes qui nous traversent.
Dans mes chaussures, il y a des grains de sable, je les y ai laissés parce qu’ils viennent de la plage de Teshima.