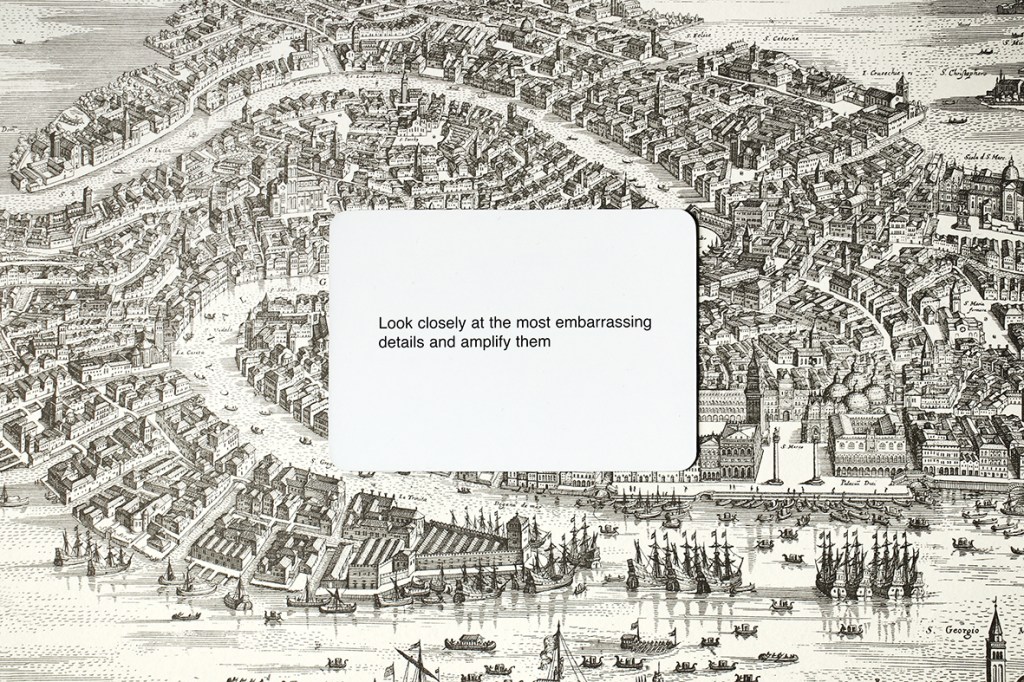Nous retrouvons Alice et Maxime place de la République. Ascension de Belleville, le parc, une brasserie. Je choisis le poulet rôti, il me semblait que c’était un plat du dimanche, même si je ne suis pas sûre d’en avoir mangé souvent, le dimanche, chez ma mère. Discussions plutôt enjouées.


Une lectrice de Comanche m’écrit par mail, je ne la connais pas, c’est mon amie Agnès qui lui a prêté le livre. Ce qui me touche c’est l’endroit de sa reconnaissance, non pas de mon travail, mais de l’absence, de l’effacement, volontaire ou induit, du silence, ce qui a été décidé pour tenir, des formules — profession du père, décédé, je la connais bien et je sais à quel point, à chaque rentrée elle vient pointer ce trou béant. Je crois que dans l’enfance, il n’y a jamais eu qu’une compassion furtive, le temps de prononcer trois syllabes, or phe line. Puis le silence, l’inquiétude muette. L’incapacité à consoler, l’impuissance des mots.
Nous regardons un film d’Yves Boisset. Kristina Janda y joue le rôle d’une Allemande, mais j’entends son accent polonais. Je ne suis pas seulement en train de dire que je reconnais l’accent : c’est une réminiscence physique. L’accent me traverse, convoquant immédiatement les visages de Piotr et Monica, la lumière blanche de Marseille l’été de mes treize ans.

Alors que nous installons l’exposition avec A, nous parlons de la quête des origines, des silences. Elle m’explique comment le mutisme de son père autour de sa propre mère, de sa grand-mère, l’a poussée à faire des recherches généalogiques. Elle s’est lancée dans un chantier d’écriture : inventer la vie d’une dizaine de personnes de sa famille, les reconstruire à partir de traces infimes, d’indices biographiques d’état civil. Je suis médusée par la joie qu’elle éprouve à inventer ces existences. Le manque ouvre un espace plus grand que la vérité. Au vernissage, Agnès arrive avec l’amie lectrice qui m’a écrit dimanche, je suis émue, je crois que nous ressentons toutes les deux le besoin de nous toucher, d’un geste qui dit je te connais.
Je trie ma messagerie, parfois j’ouvre des emails pour m’assurer de ne pas supprimer quelque chose d’important. Plongée vertigineuse. Des situations qui se répètent, des moments restés intacts dans ma mémoire, des échanges oubliés qui me troublent. Je redécouvre une assurance que j’ai l’impression d’avoir perdue tout à fait. Mais le sentiment d’être beaucoup plus libre aujourd’hui.


Neige de fleurs de cerisier. Au milieu du trottoir, deux enfants assis à califourchon sur une trottinette. Le plus grand chante Vent frais, vent du matin. Son chant est clair, presque lyrique. Ses mains battent en l’air la mesure à la manière d’un chef d’orchestre. Le plus petit l’écoute avec une intensité absolue. Être saisie par leur capacité à être pleinement là, à croire totalement à ce qu’ils font.
Comme me l’a suggéré Damien je décide de faire des tirages cyanotypes à partir de négatifs des photos prises à quatre mains au Yashica avec Nina. J’enduis le papier dans la salle de bain, je lui trouve finalement une bonne raison de n’avoir pas de fenêtre. Au moment des tirages bien sûr le ciel se voile, cette fois je vérifie les UV, ajuste les temps d’exposition. Craignant que le temps se gâte tout à fait, je procède à l’arrache. 6 x 6 cm c’est petit. Il y a beaucoup de flou et les expositions sont imparfaites. Je fais sécher sous buvard. Je rassemble les bandes en un petit paquet compact, je les glisse dans la valise pour Nice. Je cours acheter le dernier livre de Claude Favre, Membres fantômes, dont une chronique partagée sur le web vient de me rappeler l’existence, je l’ouvre au hasard, lis la phrase qui s’impose, le présent aide parfois à la beauté.