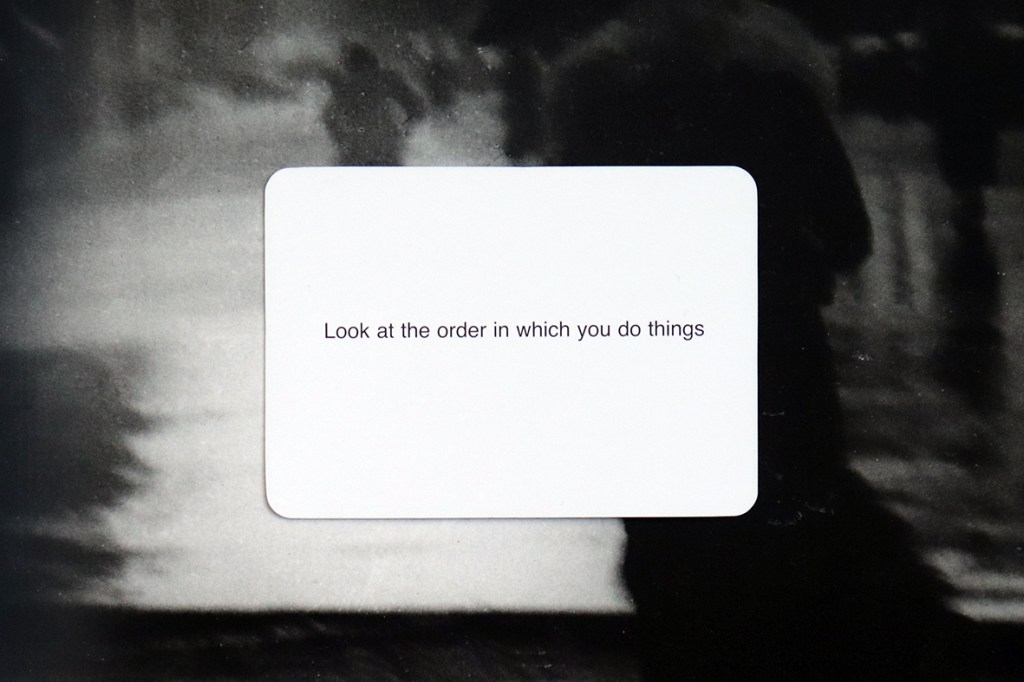Dîner avec Gracia et Erika. Quand nous sortons du restaurant la nuit est tombée, je signale l’Ange de la Bastille à Isabelle et Anh Mat. Souvent je l’ai photographié mais jamais depuis le square du boulevard Richard Lenoir, de nuit, à cette distance. Je le photographie cette fois pour me souvenir d’Anh Mat le cadrant, de son émotion, sans doute est-ce la première fois qu’il le voit.

Dernière soirée à Paris pour nos ami.e.s, nous allons dîner dehors tous les quatre. L’air est délicieux, le temps presque suspendu. Nous marchons le long du bassin de la Villette, dans ces lieux que nous connaissons par cœur et qu’Anh Mat reconnaît, familiers pour lui aussi à force de les avoir vus filmés par Philippe. En rentrant Isabelle se remet à dessiner, dès qu’elle le peut, elle dessine, cela me fait penser aux filles. Il y a déjà une pointe de nostalgie et des promesses de retour.


Au revoir émus, ce sont eux qui fermeront la maison. Dernière séance de gravure aux Arquebusiers, c’est une semaine de dernières fois. Je réalise que je n’ai pas fait le reportage escompté, et à l’arrache, je photographie quelques détails de l’atelier. Le sentiment de trop tard. La lumière crue des néons, le soleil trop fort, la disposition des lieux — rien ne se prête vraiment aux images. Je n’aurais pas même gouté un fruit du nefflier sur lequel donne la fenêtre de la salle d’encrage. En rentrant je trouve les trésors d’Isabelle dispersés dans la maison. Ses mots si émouvants, j’étais venue pour visiter Paris mais maintenant que je pars, je me rends compte que la chose la plus importante durant ce voyage c’était vous, maintenant je sais qui vous êtes.


J’essaie d’organiser la visite de L aux archives du SHD de Caen, pour qu’il photographie en haute définition le portrait de mon grand-oncle. J’explique à mon interlocuteur ce que représente cette photographie pour moi, je demande si un ami peut accéder au dossier, comment prendre rendez-vous. L’adjoint administratif principal 2e classe, me répond gentiment qu’il va me faire une fleur, qu’il va faire revenir le dossier d’Antoine, qu’il va la prendre lui cette photo, en 600 DPI si ça me va. Il ne faut pas que je sois trop pressée, il entend sans doute l’exaltation dans ma voix . Dans l’heure je reçois la photo. Le grain du papier, la rouille de l’agraphe, l’épaisseur des cheveux, la fibre de la laine, tout est là, intact, palpable.
Dans l’avion je suis frustrée, je n’ai pas pu m’asseoir près du hublot. À l’approche, alors que nous survolons la lagune, tout remonte, les images en vrac, les plus solides, les pins, les pelotes de mer, le café dans les verres fumés, les cigarettes de ma mère, le cuir noir des sandales. Et maintenant s’ajoutent d’autres choses, que j’invente et que je crois, mes grands-parents jeunes à Bastia, leurs corps dans l’ancienne rue Droite, des gestes avant moi, des voix que j’entends sans les avoir jamais entendues. Et chaque voyage, chaque atterrissage ravive cette chose sans nom, c’est incontrôlable, ce qui avant s’apparentait à de la peur, c’est maintenant une joie intense emmêlée au chagrin, pertes et retrouvailles, souvenirs inventés et rééls, tout ce qui revient malgré moi.

Premier matin, l’aubade monte du dehors, lointaine. J’hésite à me lever. Dans le demi-sommeil remontent par vagues les marches tièdes d’une maison de village, les pierres usées sous les pieds nus, le sel sur la peau, la poussière blonde de l’été. Je reste encore un peu, les yeux fermés, le corps engourdi par la nuit. Quand je me décide enfin, le soleil est déjà au-dessus de l’horizon, réchauffe le bleu du ciel, l’air est tiède, poreux, traversé de lumière. Le jour est là, sans hésitation, tout entier, comme si rien n’avait jamais été quitté.