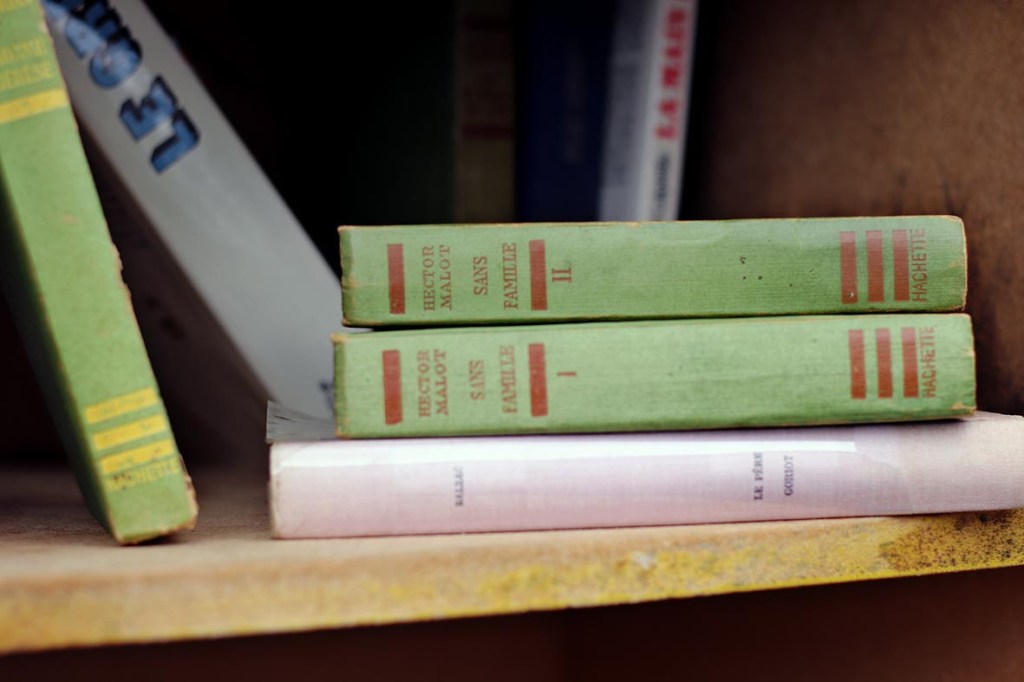La semaine s’est emballée et je ne suis pas sûre d’être capable d’en remonter le fil. Sensation que les jours se sont rabattus les uns sur les autres, comment désigner ce qui a compté, ce qui aurait mérité d’être retenu ? Le journal me résiste et pourtant je ne sais pas à renoncer à ce rendez-vous hebdomadaire, à cette tentative répétée de mettre un peu d’ordre.


Le café dans l’air vif, puis les hauteurs de Montmartre. La trace de Rome, puis de Venise dans les détails, des villes logées dans une autre.
Le déjeuner rue des Taillandiers. La cuisine et le service authentiquement japonais, et mon coeur qui s’est mis à battre plus fort.

J’essaie d’avancer sur un fragment de Corbera, l’ordinaire des jours qui ont précédé le départ au Canada. De cette période, je ne sais presque rien, il n’y a pas de récit.
Seulement quelques dates, le mariage, la naissance de mon frère, les photographies de Noël. Je ne peux qu’imaginer, mais imaginer reste une opération fragile. Ma mère et moi sommes si différentes. Avoir vingt-deux ans en 1962 n’a rien à voir avec ma propre expérience de cet âge. Vivre en couple à ce moment-là n’obéissait pas aux mêmes règles. Leurs gestes, leurs attentes, leur liberté, qu’avons nous en commun ? Le monde n’était pas réglé par les mêmes peurs, ni par les mêmes promesses.
J’entends The Man I Love, je pense d’abord à Pina Bausch, puis à Arnold.
Je travaille sur la miniature. Je recommence à penser l’espace, je prends des mesures, je réduis, j’ouvre des fenêtres. Je reproduis le motif du carreau de ciment de la chambre d’Erbalunga qui n’existe plus. Il s’agit toujours de donner une forme à une absence. J’imagine un tiroir qui se logerait sous le sol, un espace caché, à l’intérieur seraient abrités les souvenirs, sous forme de bandes de textes tapuscrits.
le parfum de l’asphalte mêlé à celui des figuiers
le surgissement de la citadelle dans la lumière du soir
les cheveux gorgés d’eau de mer
le café dans les verres teintés
la lune qui se lève sur l’horizon comme un soleil
les montagnes en copeaux de chocolat
la voiture gorgée d’air chaud
les vitres qu’on baisse pour l’illusion de fraîcheur
le grésillement de l’allume cigare
l’odeur d’encens et de tabac blond
l’aube, son odeur de pluie froide
la vigueur du soleil
l’ombre nette des palmiers sur la place
l’obstination des fourmis
l’odeur rance et poudrée de son rouge à lèvres sur mes pommettes
la lumière du phare de Pianosa à l’horizon
chaque matin la même lumière, le même éblouissement, le même feu
l’aube d’été ouverte par les chants d’oiseaux
le soleil déjà tiède, suspendu dans l’air sec
une lumière venue d’ailleurs, surnaturelle, ardente
l’eau alourdie de chaleur
un scintillement dans la dentelle des arbres
son parfum de peau ambrée …/…


Philippe, exceptionnellement, ne travaillait pas ce samedi. Il travaille sur les corrections du texte à paraitre en mai. Le ciel s’obstinait dans le bleu alors nous sommes sortis, et le ciel s’est couvert. Nous avons rejoint la rue Bonaparte pour découvrir la miniature installée dans la vitrine de la nouvelle boutique d’Antoinette Poisson. Bien que celle ci soit décorative, elle exerce toujours une même fascination. Je me demande d’où celà vient, peut-être parce que tout semble être à sa place, contenu, et nous donne l’illusion d’un monde habitable. On repartant on avait des lumières sublimes sur la Seine et je me suis dit que j’allais écrire le journal.
La nuit est tombée, et pourtant j’ai entendu une foule de chants d’oiseaux.