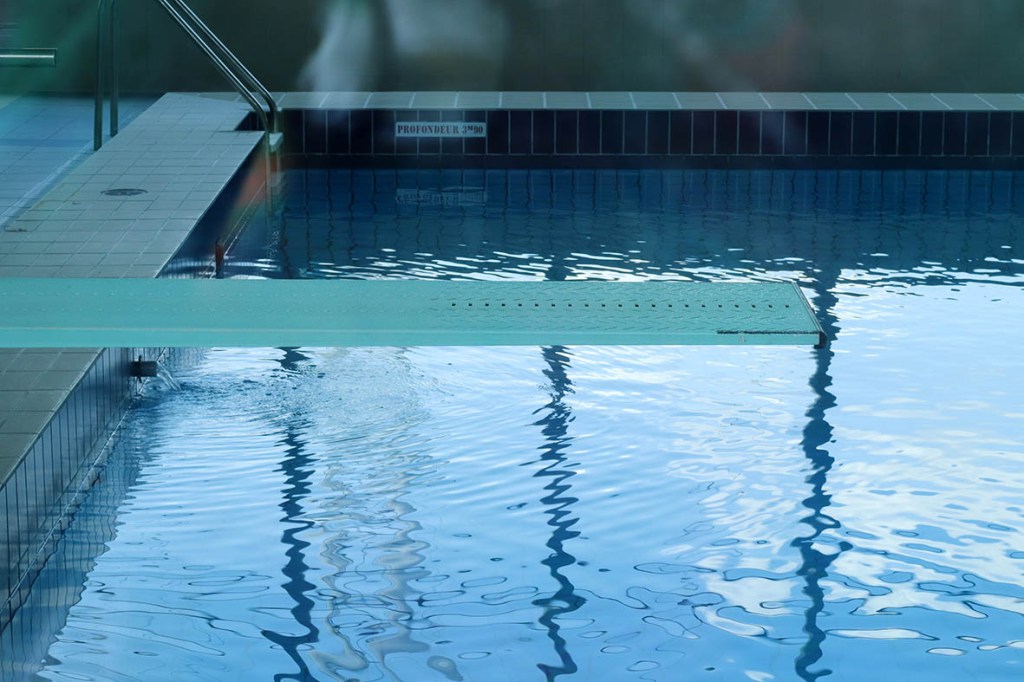Marche au bassin de la Villette, puis au jardin partagé du jardin d’Éole.
Série de cyanotypes avec accidents, au moment du virage au thé, les images s’effacent, je découvre que les pigments ne résistent pas à la chaleur. Anh Mat confirme sa venue à Paris. Je prépare les chambres des filles, je crois qu’elles resteront toujours leurs chambres. En époussetant la maison de poupées, j’imagine Isabelle la découvrant. Je me demande si elle fera parler les personnages, si elle changera les meubles de place.


Visite du salon de l’estampe. Mon regard et mon attente ont changé. Il est rare que je me laisse porter comme les premières fois, désormais je décortique, je plonge dans les gris et les textures, je cherche à deviner quel outil, quelle technique il y a derrière les images qui attirent mon regard. Le lendemain, je reprends mes essais de surimpression — gravure sur cyanotype. J’accumule sur mes petits formats, et l’accumulation est réjouissante. Je ne me pose pas de questions, je fais, je comprendrai après.

Déjeuner avec Camille. Nous ne nous sommes pas vues depuis longtemps. Nous sommes liées par l’histoire de nos parents, mais surtout par un lieu, Edenville. Un nom rare, presque mythique, qui semble venir d’une Amérique dont nous ne rêvons plus depuis longtemps. Elle a vécu dans la même maison, L’Îlot, une dizaine d’années après moi, au même âge. Je devine chez elle la même nostalgie, elle a avec cette maison un même sentiment de dépossession je crois. Une maison quittée, perdue, vendue, une maison dont on n’a pas décidé le sort. Et au-delà des souvenirs, nous avons le même émerveillement à nommer ces lieux, L’Îlot, Edenville. Et le sentiment de réassurance de partager cela avec elle, que le souvenir du lieu trouve un écho dans une autre voix.
Déambulation avec Anne Savelli autour de ses Oloés, dans son quartier (qui est aussi un peu le mien). Je connais la plupart des lieux que nous traversons. Mais marchant à côté d’elle, je trouve qu’ils résonnent autrement, d’autres liens se tissent. Devant le 19 de la rue de l’Atlas, où Georges Perec prétend être né, se dresse un immeuble construit dans les années 1930 — ce qui contredit la croyance de Perec. Dans cet immeuble vit Lya, une artiste, amie d’Anne, qui nous accueille dans son appartement de poche. Je trouve merveilleuse cette possibilité d’entrer chez une inconnue. Dans l’espace réduit s’accumulent les œuvres, la laine, la documentation, parfaitement ordonnées dans des boîtes dissimulées par de grands voilages. Un lieu minuscule qui semble contenir tout un monde. Il y a quelque chose d’extrèmement touchant dans cette tension entre l’étroitesse de l’espace et l’amplitude intérieure qu’il dégage. Lya est aussi modèle, et j’apprends qu’elle a posé à Duperré où j’étudiais — je l’ai peut-être dessinée. Le lendemain de notre rencontre j’en ai la certitude.


Je vais accueillir Anh Mat et Isabelle à la Gare de l’Est. Se rencontrer physiquement est très troublant. Comme, exceptionnellement, ils n’ont aucune visite de musée prévue aujourd’hui, je décide de ne pas travailler. Pour aller aux Buttes Chaumont nous reprenons une partie de l’itinéraire accompli la veille avec Anne, avec une pause à la bibliothèque. Nous avons la surprise de découvrir le siège du Parti communiste ouvert, il s’y tient une exposition autour de l’anniversaire de l’indépendance du Vietnam, on y voit bien sûr un signe. Nous arpentons les Buttes Chaumont, en quête de fraîcheur et de verdure. S’asseoir près de la rivière, traverser une pente herbeuse et tiède nu-pieds. La présence d’Isabelle fait ressurgir l’époque où nous venions ici avec Philippe et les filles petites. Je m’effraie de la rapidité avec laquelle ces années ont filé.
Avec Anh Mat, nous parlons de nos gestes, de nos pratiques d’écriture. Est-ce que l’écriture a besoin de devenir livre, quand elle existe dans l’échange, dans nos carnets, nos messages, nos marches. Je crois que malgré l’appréhension nous parlons sans doute la même langue, une langue pour comprendre, pour relier, une langue qui se passe de reconnaissance mais non de partage.