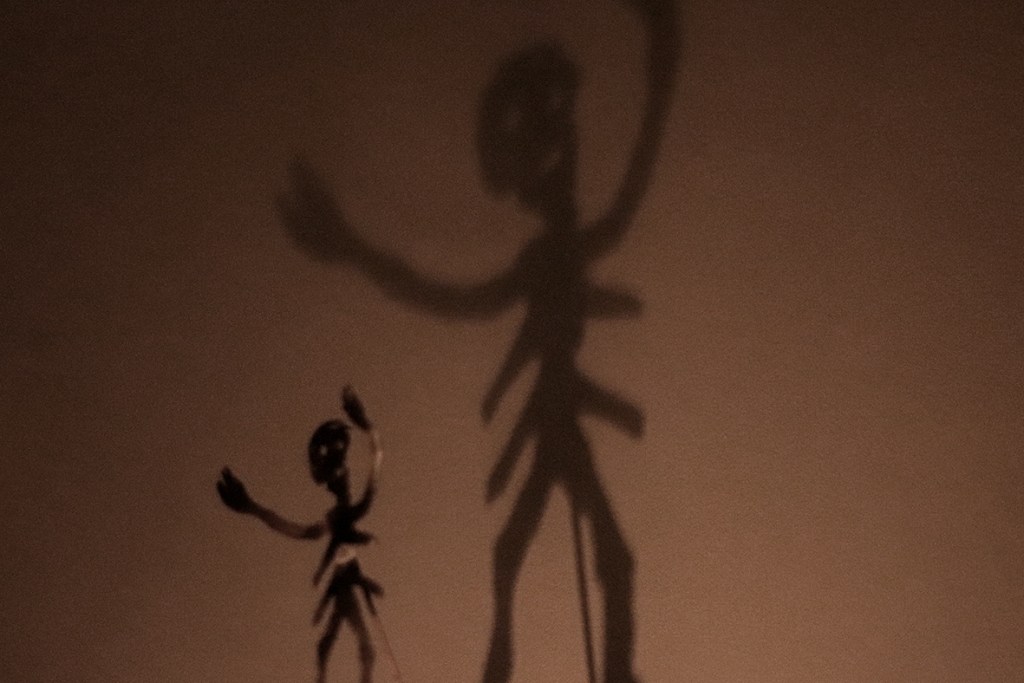Nord, sud, est, ouest ? Mer, montagne, campagne ? On ira à La Butte-aux-Cailles, à la fois montagne et campagne sous un ciel bleu intense.
Le vieillard était déjà là. Le temps long de son café, il s’endort par intermittence au-dessus du journal dont il griffone les pages. Il prend la monnaie qu’il serre dans un petit sac en plastique. Il tente de se lever. Ses mains s’agrippent au dossier de sa chaise, ses jambes se dérobent. Je suis seule à l’observer et m’inquiéter pour lui, je crains qu’il s’effondre. Il attend que la force remonte dans son corps. Puis il prend le temps de débarrasser sa table, il s’immobilise, puis s’élance vers le bar. Philippe me fait remarquer qu’à le regarder maintenant marcher au dehors, il semble revigoré.


Je photographie les lapins en papier jaune collés sur un mur tagué en pensant à Claude Chambard. Comme je pense à François Bon quand je vois des engins de chantiers. Comme une réprésentation de Marilyn me fait irrémédiablement penser à Anne Savelli. Comme je pense à Anne-Marie Garat en traversant le Jardin des Plantes. Toi ce sont les reflets, les panneaux de signalisation, la ville, toi tu es toujours là.


Les entendre est désespérant, leurs appetits immondes, leurs phrases relayées par les journalistes atones, des phrases qui nous sidèrent, on se demande d’où elles tombent.
Chaque matin je surveille les mouvements du ciel, il finit par s’ouvrir, et me rappeler d’autres matins.

J’étale les cyanotypes de cet été sur le sol, j’essaie de composer un ensemble, il y a les mots de Marine, les lieux se brouillent les uns contre les autres. J’ai l’intuition qu’en les rapprochant un monde se reconstruit et ça me donne beaucoup d’espoir.
J’entends une voix, d’abord je ne sais pas d’où elle vient, une petite voix qui semble monter du sol, puis c’est mon prénom que j’entends, Caroline, Caroline, c’est Milène qui tente de me prévenir, j’ai déclenché un appel vidéo accidentellement avec mon teléphone, sa voix qui venait de loin, minuscule et grave, c’était une voix de fée.