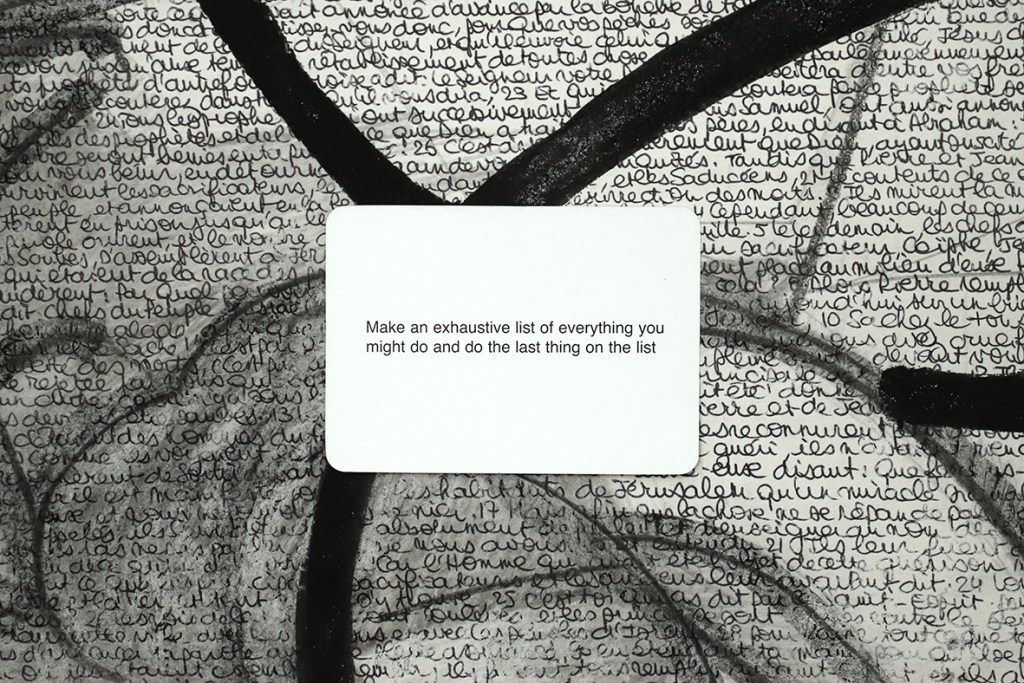C’est dimanche, visite de l’exposition de Mathilde Hess à l’atelier Lardeur sur la suggestion d’Hélène Gaudy, le lieu fascine, la lumière, les traces accumulées, la beauté des cerfs volants se frottant au mur, les reflets.


Pour rentrer à la maison nous traversons la foule du jardin du Luxembourg, des touristes, des joueurs d’échecs, leurs spectateurs, des couples amoureux, des enfants autour du bassin qui poussent des bateaux à voiles avec leurs bâtons. Je n’ai quasiment pas de souvenirs de ce jardin, je l’ai sans aucun doute déjà traversé, mais je n’y ai jamais passé de temps, je n’y ai jamais joué au tennis, ni lu de livre sur une des fameuses chaises vertes dans l’espoir d’une rencontre. Je me trompais. Alors que nous quittons le parc me revient le souvenir d’une soirée passée chez la famille H à Paris, j’avais peut-être huit ans ou neuf ans, et il me semble que les H vivaient rue de Rennes. Le père était médecin, dont ma mère avait été la patiente, avant de se lier d’amitié avec lui — elle se rapprochait ainsi de tous, ses médecins, ses banquiers, ses voisines. La mère était avocate. Lui était juif, elle était corse, pour ma mère c’était important, comme si leurs origines en faisaient des êtres supérieurs. À mes yeux d’enfants cette famille était exagérément riche, qui vivait dans cet appartement haussmannien avec parquets en point de Hongrie, des doubles portes vitrées à petit carreaux, des corridors, un piano, des tapis d’orient, une chambre de bonne, mais ça n’empêchait pas cette relation d’amitié qu’entretenait ma mère. Les H avaient trois enfants, dont la cadette, A, avait à peu près mon âge. Elle me fascinait, belle lumineuse, douce. L’évidence que nous pouvions être amies. Ses boucles brunes autour de son visage fin, l’ascendance juive, j’établissais immédiatement une ressemblance entre A et Anne Franck. J’étais trop jeune pour avoir lu Le Journal mais comme tout le monde j’aimais Anne Franck, comment ne pas aimer l’adolescente au destin tragique, son regard, son sourire sur le portait sépia de la couverture du livre que ma sœur étudiait au collège. Cette ressemblance — à vrai dire je crois que l’ai imaginée — renforçait ma fascination. À la fin de la soirée je ne voulais pas quitter A et je fus miraculeusement autorisée à passer la nuit chez les H, ma mère me récupèrerait le lendemain, les deux petites s’entendent bien. J’ai peu dormi, comme on dort mal dans une chambre inconnue, comme on guette la nuit les bruits nouveaux, comme on sait qu’on est pas tout à fait à sa place. Le lendemain matin on nous proposa une balade au Luxembourg, et voyant comme j’étais attirée par les petits poneys on nous permit de faire une promenade dans les allées sablonneuses du jardin. Je n’ai aucune autre image qui me revient de ces heures passées en compagnie de A, je ne crois pas l’avoir revue, nous n’habitions pas Paris, avions déménagé très souvent, les liens entre ma mère et les H avaient fini par se rompre. Mais le souvenir de ma fascination est intacte.