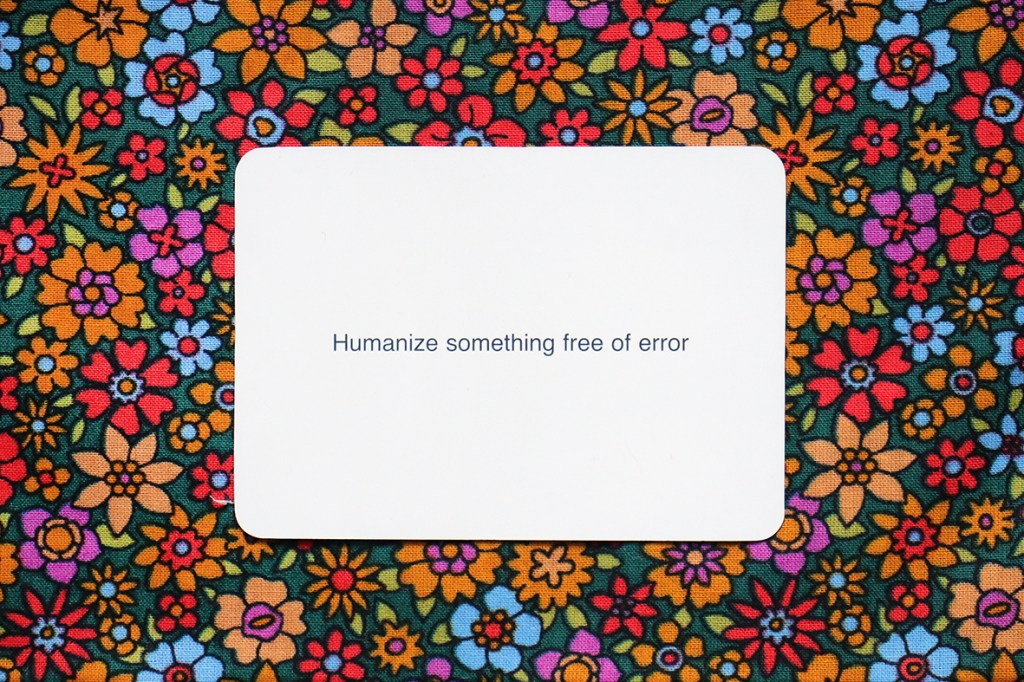Les filles à la maison. Et mon énergie dévorée. Fatigue de fin d’année. Saturation des réseaux. L’impression de trop-plein avant même qu’elles arrivent. Heureusement, elles ne sont plus des enfants. Pourtant Nina me l’a dit il y a quelques jours, à la lecture du journal elle a parfois l’impression que je parle d’elles comme si elles étaient encore petites.
Je jalouse Philippe, sa capacité à travailler dans le salon, au milieu de leurs échanges. Il a toujours su s’extraire. Je n’ai jamais cherché à le faire. J’ai longtemps cru que c’était une question de tempérament. Finalement, je crois que je n’ai jamais pensé que c’était possible. Il a fallu les retrouvailles inespérées avec ma tante, puis le projet Comanche, puis l’autonomie des filles, pour que s’ouvre la possibilité d’écrire.


J’ai évité un corps couché à même le sol, cherchant un peu de chaleur sur les grilles d’aération du métro. C’est le Noël le plus froid depuis quinze ans. La phrase tourne en boucle.
Je n’ai pas la nostalgie de mes Noëls d’enfance, je les ai oubliés. Mais je me souviens de la joie de certains cadeaux. Un couffin reçu à Corbera. Un beau livre offert par Véronique, Histoire d’un casse-noisette. Je me souviens surtout de son poids, de la lenteur du récit, des illustrations précieuses et mystérieuses, plus importantes pour moi que l’histoire elle-même, peut-être qu’elles sont à l’origine de ma vocation. Je n’ai aucune nostalgie de ces fêtes passées en famille. Pourtant, pour la première fois depuis des années, un sentiment de manque.

Alors que l’IA dévore la planète, je déballe mes cadeaux de Noël. Un programme de relaxation politique à objectif tendrement insurrectionnel, un guide de randonnées autour de Paris, une ode à la résistance poétique et politique, un gilet crocheté à la main, enfin deux essais sur l’IA.
Il, elles pansent ma colère. M’invitent à marcher. Respirer.
Période foutraque, épuisante mais joyeuse. Je me concentre pour savoir quel jour nous sommes. Les projets s’accumulent et restent en attente. Corbera est là, massif, exigeant, en sommeil, je me demande parfois si je ne devrais pas renoncer au journal pour lui accorder toute mon attention. Je me demande si le journal ne me donne pas l’illusion de travailler. Je ne suis pas sûre que Corbera avancerait davantage sans le journal. Sans lui, beaucoup de choses se dissoudraient avant même d’avoir été nommées. Le journal est déjà une forme, l’écarter au nom d’un projet plus ambitieux serait sans doute une erreur.

Finalement, la seule chose que je me sente capable d’attaquer en cette fin d’année, c’est ma création pour le festival Miniature. Peut-être parce que le thème, voyage mémorable, m’autorise quelque chose de plus intime. J’entrevois comment y mêler différentes techniques, comment faire tenir ensemble des images, des matières, peut-être du texte. Un objet personnel. Je commence par fabriquer le lit en métal de la chambre disparue d’Erbalunga.


Nous marchons pour rejoindre le parc de la Butte du Chapeau Rouge. Beau soleil, froid glacial. Le parc est désert, un jardinier semble surpris de nous voir, nous salue, puis sa collègue qu’on aperçoit dans les buissons nous salue à son tour. Prendre de la hauteur. Les perspectives s’ouvrent dans la lumière tranchante et les arbres nus dialoguent avec la ville.