
Nous passons par la Grange aux Belles, tu me confies que l’objet métallique, auparavant incrusté dans le bitume, cet objet dont Nina se souvenait précisement, que tu avais trouvé en marge du chantier du pont, que tu avais dissimulé au dos d’un arbre avant notre départ ne sachant pas qu’en faire, a disparu. Je l’aurais sans doute oublié, mais de l’avoir longuement évoqué à Nice avec Nina, il avait pris une certaine importance, je te trouve bien imprudent de l’avoir abandonné derrière cet arbre et mon coeur se serre un peu. Au retour de la Mouzaia, des glycines, du bistrot, des Buttes, j’écris, je ne crie pas victoire mais l’énergie revient, et avec elle beaucoup d’autres choses.
Je ne suis pas dans la quête d’une belle image, je cherche plutôt à mémoriser l’instant, ou à prendre une note via la photographie. Et il m’arrive d’écrire plusieurs fois la même chose. Le Temple de la Sybille n’y échappe pas, je ne sais pas si elle convoque un souvenir enfoui, mais sa silhouette romaine dans ce décor à l’anglaise, me raccroche à une chose du passé que j’ignore.

J’appelle Adnane, en quête de détails pour décrire le trajet de l’aéroport d’Alger à la maison de Nadira. À distance il me guide sur Google Maps, cherchant précisément un virage, un repère, quand je veux juste savoir quelle architecture, quelle végétation, quelle vue… Je sais désormais qu’il y a un citronier, un figuier, des bougainvilliers dans le jardin. On évoque le voyage que je ferai peut-être un jour, les tensions franco-algeriennes, le fait que bien que née à Alger je n’ai jamais demandé la double nationalité. Le fait que oui, il faudra que j’aille à Alger, mais que vraiment il faut découvrir le Sahara, qu’il n’y a rien de plus beau que le désert.
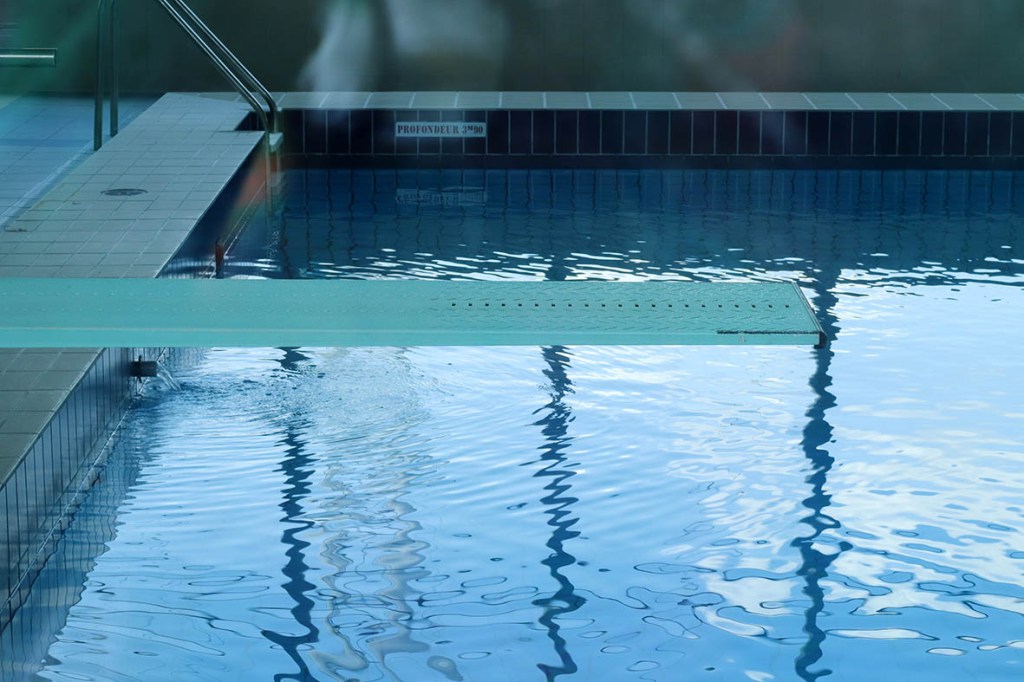

Il est recroquevillé dans un renfoncement en position presque fœtale, ses chaussures trouées, la teinte brune de sa peau, son corps rétréci. Au-dessus de lui un collage, une phrase en lettres capitales, LE SILENCE PROTÈGE LES BOURREAUX. C’était étrange comme elle résonnait à cet endroit. Je me suis demandé s’il l’avait lue, s’il l’avait choisie inconsciemment pour veiller sur lui, ou pour signaler sa présence.
C’est une chaleur déraisonnable, mais il y a le plaisir de retrouver certaines sensations.

Nous achetons des croissants dans une boulangerie du boulevard de Belleville, peut-être parce qu’ils sont chauds, ça nous rappelle les croissants qu’on faisait cuire enfants à la maison, la fausse magie des croissants Danerolles. Peut-être parce que c’est le premier mai et qu’il fait beau les gens ont l’air heureux. À l’angle de la rue Étienne Dolet et de la place Maurice Chevalier, le graffe de Zoo Project est presque totalement recouvert, seule sa signature apparait encore sur le côté. Alors que Anne m’envoie un message pour me dire que dans la file d’attente de la piscine il y a devant elle deux jeunes gens qui parlent de Chantal Akerman – je crois que comme moi elle y trouve une raison de se réjouir, nous arrivons sur l’allée qui porte son nom, à Ménilmontant. Nous buvons un café à La Laverie, dont les grandes fenêtres ouvertes sur la place en contrebas m’évoquent une scéne de théatre. Je vais payer au comptoir, le serveur me confie qu’il boit un thé blanc, il trouve que ça n’a pas de goût, que ce n’est pas très bon, en fait, mais qu’il ne peut tout de même pas le jeter parce que ça coûte très cher. Toutes ces paroles paraissent inutiles mais ses gestes, sa voix, son sourire, sa volonté de se lier me font du bien.

J’ai repris depuis quelques mois l’atelier d’écriture de François Bon. Je ne l’aborde plus du tout de la même manière (comprendre je n’ai plus l’impression de jouer ma vie à chaque fois, oui j’exagère). C’est devenu une sorte de discipline, et parfois j’ai de bonnes surprises. Pour le dernier atelier on s’appuyait sur Manuela Draeger, marcher dans le rêve et la nuit. J’ai fouillé dans mon blog où il m’arrive de noter des rêves (joie des mots clefs). J’en retrouve un qui se glisse plutôt bien dans la consigne, je passe du jeu au nous, trouve de nouveaux appuis, donne une couleur plus sombre au rêve initial, si bien qu’à la fin j’ai un nouveau souvenir de ce rêve. Et puis Philippe me dit que d’avoir lu mon texte l’a aidé. Et là je découvre qu’il est entré dans mon rêve, il en a repris la matrice, mais lui a donné une autre couleur, ma ville rêvée est désormais post apocalyptique. J’ai du mal à définir ce qui me trouble autant, de me sentir dépossédée de ce rêve ou de faire l’expérience d’une autre temporalité, d’une réalité parallèle. Une mise en abîme du rêve, nous voilà totalement chez Marker.
Je vais peu au théatre, G vient de m’offrir une place pour Macbeth à la Comédie Française. C’est la première fois que j’entre dans ce théâtre et je ne suis pas la seule, autour de moi les mêmes gestes, on se photographie dans les escaliers majestueux, on photographie les sculptures, les lustres, les plafonds. Sur la scène, Lady Macbeth nous attend, assise devant un portrait, visage enfoui sous de longues mèches rousses qu’elle lisse puis arrache par poignées. Des chuchotement, quand nous retrouverons-nous. Et puis je finis par rester sur le bord, tout est un peu trop figé, je vois les trucs de mise en scène. En sortant du théatre, j’avise le ciel, je pense avoir le temps d’arriver à la maison avant la pluie. J’ai à peine roulé cinq cents mètres qu’il pleut, que ça se transforme presque immédiatement en grêle, qu’il y a des premiers éclairs, que je suis trempée, que les grêlons grossissent à vue d’œil et me font mal. Je rejoins d’autres personnes surprises par l’orage sous la bâche d’un restaurant italien rue Réaumur. Ça ne dure pas longtemps mais c’est sidérant. En rentrant, alors que mes doigts allaient se poser sur le digicode, je sursaute, il y a une énorme araignée immobile.








